L’erreur principale qui est faite par mes collègues scientifiques est une erreur que je qualifierais d’erreur structurelle.
L’invention de l’existence d’un effet de serre trouve son origine dans une constatation en apparence et au premier abord déconcertante.
Cette constatation un peu étonnante est ensuite approfondie, certes, mais l’analyse qui est menée l’est à mon sens de façon erronée parce qu’en dehors de la logique. Quelle est cette constatation ?
Voici :
Il semblerait bien, et après beaucoup de temps passé pour tenter de comprendre ce qui se passe exactement sur notre planète, j’en suis tombé d’accord, que le soleil n’éclaire pas suffisamment la Terre pour expliquer les températures qui y sont observées. Il est admis aujourd’hui, après forces recherches, que si les températures sur Terre sont aussi différentes par exemple que celles observées sur la Lune, cela viendrait de la présence de gaz à effet de serre dans l’atmosphère de la Terre. Je pense pour ma part que cette dernière conclusion repose sur des raisonnements faux et sur des calculs également faux. Dans la réalité, s’il est vrai que le Soleil n’éclaire pas suffisamment la Terre, il est par contre plus que probable que la différence de température entre la Terre et la Lune ne s’explique pas par la présence des gaz à effet de serre. Selon moi elle s’explique essentiellement par deux éléments, qui sont tous les deux gommés dans les raisonnements tenus.
Le premier de ces deux éléments est la présence de l’océan, qui représente le seul vrai et significatif « réservoir » de chaleur (ou d’énergie interne au système Terre-atmosphère, si vous préférez), et garde donc bien davantage la chaleur prisonnière que ne le font les gaz à effet de serre et notamment le coupable désigné que serait le dioxyde de carbone. Ce que le CO2 de l’atmosphère garderait comme chaleur prisonnière est plus qu’infinitésimal et donc non mesurable, à côté de ce qui est « gardé » par l’océan.
Le second de ces éléments est la présence de l’atmosphère elle-même en tant que telle. Cette atmosphère possède un poids conséquent, en tenant compte de son oxygène et de son azote et non pas seulement de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone qui ne représentent au grand maximum qu’environ 0.25% de ce poids (jusqu’à 4% en volume). Il en résulte ce que l’on appelle la pression atmosphérique, laquelle est lourde de conséquences sur les températures régnant dans l’atmosphère et notamment au sol, tout en bas de cette enveloppe de gaz qui nous entoure. Les calculs de pression permettent de montrer qu’il existe un gradient thermique variable selon l’importance de l’humidité et (peut-être, mais dans des proportions bien moindres, vu le poids quasi négligeable) selon la teneur en CO2. Il ne s’agit pas à proprement parler de chauffage au sens où il n’y a derrière ce phénomène ni convection, ni conduction, ni rayonnement. Mais il s’agit bel et bien d’une modification des températures, par rapport à la Lune par exemple. Cette modification est due à la gravitation et il est indispensable de la prendre en compte. Songeons que sur le Soleil, c’est la gravitation qui au final est responsable de la température à la surface de cet astre. C’est en effet en raison de la pression considérable qui y règne que se déclenchent au centre de notre étoile les réactions nucléaires qui s’y produisent. La gravitation est, sur le soleil, la seule cause de sa température en surface de quelques 5 500°C… Sur la terre, son influence se fait bien évidemment aussi sentir, par le biais du gradient thermique, lequel est causé par les différences de pression entre le haut et le bas de l’atmosphère. Négliger cet élément est une grave faute scientifique.
En outre, il y a dans les raisonnements tenus par le GIEC et ses partisans des fautes de logique. J’y vois d’une part un raisonnement de type circulaire et une contradiction logique.
Examinons-les un par un :
a) Raisonnement circulaire:
Il y a dans l’hypothèse de l’existence d’un effet de serre, un raisonnement circulaire.
Prenons l’exemple de la température du soleil pour bien cerner où est le raisonnement circulaire dans le cas de la terre. Nous observons une température de 5600°C à la surface du soleil. Ceci permet de calculer la puissance émise par le soleil, qui dépend de cette température d’après la formule de Stefan-Boltzmann, qui relie la puissance à la température. Inversement, la mesure de la puissance du soleil permet de déterminer sa température de surface.
Mais ces deux constatations ou mesures ne permettent en aucun cas de comprendre pourquoi la température de surface du soleil est ce qu’elle est, soit 5600°C. En effet, dire que c’est parce que la puissance d’émission du soleil est de 1357 W/m² à la distance de la terre que sa surface est de 5600°C ou dire que c’est parce que la température de surface est de 5600°C que sa puissance est de 1357 W/m² n’explique rien. Ce genre de discours tourne en rond : c’est un raisonnement circulaire qui ne répond pas à la question de fond : pourquoi le soleil est-il à une température de surface de 5600°C ? La réponse est à chercher en dehors de ce cercle vicieux, à savoir dans les réactions nucléaires qui se déroulent à l’intérieur du soleil et qui, en dernier ressort, sont dues aux forces considérables exercées au centre de notre astre par la gravitation.
Or les bilans radiatifs du GIEC et ceux qui s’en inspirent font tous très exactement ce type de raisonnement. Il est déclaré que le sol émet un rayonnement de 390 W/m², en cohérence, nous dit-on, avec sa température moyenne de 15°C. Ceci serait effectivement cohérent si on ne s’en servait pas pour justifier l’existence des back-radiations, en réalité totalement inventées, qui en résulteraient. D’où viendrait l’existence de ces back-radiations ? D’après les « explications » données, elles seraient nourries par le rayonnement du sol et expliqueraient pourquoi ce sol est précisément à 15°C. Il est parfaitement évident que ce raisonnement tourne en rond. Le sol étant à 15°C, ce qui n’est nullement justifié au départ, mais seulement mesuré, il envoie un rayonnement correspondant à cette température vers l’atmosphère, qui à son tour le retourne vers le sol, expliquant ainsi que le sol soit à 15°C ! Magnifique exemple de raisonnement circulaire ! Finalement, le sol est à 15°C parce qu’il est à 15°C. Nous voilà dûment renseignés !!!
Voici une « explication » donnée pour les 15°C observés au sol :
« les 15°C moyen que vous évoquez résultent des conditions d’équilibre entre l’énergie thermique pénétrant le système et l’énergie thermique s’en échappant. »
Dire que ces 15°C résultent des conditions d’équilibre entre l’énergie thermique pénétrant le système et l’énergie thermique s’en échappant n’a aucune espèce de force convaincante. Car cet équilibre n’explique toujours pas pourquoi les corps sont précisément à 15°C, cela explique seulement qu’ils sont en équilibre, donc qu’ils sont à la même température. Mais quelle température ? On ne le sait toujours pas.
Prenons la comparaison suivante pour le comprendre. Vous êtes fiévreux. Vous voulez savoir quelle est la température de votre corps. Pour cela, vous procédez comme le fait le bilan radiatif proposé par le GIEC et ses partisans. Vous mettez vos deux mains en face l’une de l’autre. Vous constatez qu’il y a des conditions d’équilibre : vos deux mains sont à la même température. Question : quelle est votre température ? Vous n’en savez rien…
L’argument donné n’explique donc nullement que le sol et la base atmosphère soient à 15°C, il explique seulement qu’ils sont à la même température. Et la question se pose toujours : pourquoi cette température serait-elle de 15°C ?
b) Contradiction :
Il y a en outre dans l’hypothèse de l’existence d’un effet de serre, une contradiction : le rayonnement sortant du système terre-atmosphère doit baisser et augmenter en même temps.
Voici la poursuite de « l’explication » ci-dessus :
Les GES ont une incidence (à la baisse) sur le flux sortant et cela déplace l’équilibre du système occasionnant une augmentation de la température atmosphérique au niveau du sol.
S’il était vrai que l’incidence des GES sur le rayonnement sortant soit à la baisse, cela voudrait dire que l’atmosphère augmenterait de température au niveau du sol et chaufferait le sol. Dans ces conditions le système tout entier devrait être plus chaud et donc le flux sortant devrait augmenter en conséquence, parce qu’un corps rayonne davantage lorsqu’il est plus chaud. Le flux sortant devrait donc en même temps baisser et augmenter. Il s’agit là d’une belle contradiction logique.
c) Erreurs de calcul:
Par ailleurs, pour arriver aux conclusions erronées sur l’existence d’un effet de serre, l’action du rayonnement solaire est calculée, la plupart du temps, d’une façon que je ne puis que qualifier de très étrange, très éloignée selon moi de la rigueur scientifique. Voyons un exemple de raisonnement universellement répandu.
Voici : « Sur Terre (nous allons supposer que la Terre ici évoquée est en réalité le système Terre-atmosphère, sinon ce serait encore plus absurde !) tout se passe comme si chaque mètre carré recevait en moyenne 340 W/m². »
Ce chiffre est, nous dit-on, justifié en distribuant l’énergie totale reçue par le système Terre-atmosphère sur la surface entière de la planète, après déduction de la partie renvoyée directement vers le cosmos, laquelle est appelée « l’albédo ». Je précise que l’énergie totale évoquée est, quand à elle, calculée correctement. L’albédo, bien que sujet à de nombreuses incertitudes, est cependant évalué de façon très plausible. Le véritable problème que je me dois de souligner en tant que mathématicien est le fait de « distribuer » l’énergie totale sur la sphère terrestre entière. Au nom de quoi fait-on cette distribution qui n’existe pas dans la réalité ? Il est avancé, par exemple, l’argument de l’inertie thermique de l’océan, qui est considérable. Selon cette théorie, cette inertie thermique justifierait la distribution ainsi faite. D’autres arguments évoquent la diffusion de la lumière par l’atmosphère, la présence des courants océaniques ou atmosphériques, bref divers phénomènes propres à la Terre et qui n’existent pas sur la Lune.
De tels raisonnements sont absurdes et sont contraires aux faits. Pourquoi ?
a) Ils ne tiennent pas compte de l’existence du jour et de la nuit. Dire que tout se passe comme si chaque mètre carré recevait la même dose de rayonnement, c’est dire que tout se passe comme si l’ensemble de la sphère céleste éclairait la Terre depuis toutes les directions, chaque mètre carré recevant la même puissance en watts.
Dans la réalité, le Soleil est dans une seule direction et n’éclaire qu’une seule face de la Terre. Ce fait est nié, purement et simplement…
b) Ils ne tiennent pas compte du fait que la Terre soit ronde. Dans la réalité la Terre est ronde et il en résulte entre autres que les pôles ne reçoivent pas la même dose de rayonnement que l’équateur. Ce fait est également nié.
c) L’argument de l’inertie thermique ou de la diffusion de la lumière due à la présence de l’atmosphère est très précisément l’illustration même de l’erreur de raisonnement de type structurel que j’évoque au départ de cet article. C’est une erreur à double titre.
C’est tout d’abord une erreur de méthode, qui pratique à tort ce que j’appelle le mélange de deux phénomènes, faussant l’analyse de l’un d’eux, à savoir le rayonnement solaire. Ce dernier n’a pas à être mélangé avec l’inertie thermique de l’océan, qui n’a rien à voir.
D’autre part il repose sur une impossibilité. Il ne se peut pas en effet que l’océan situé au sol et l’atmosphère située juste au dessus puissent avoir une influence quelconque sur le rayonnement solaire, qui arrive, lui, du cosmos. Cette influence se téléporterait vers l’extérieur. Quand à la diffusion ou à la circulation dont il est parlé, voici ce que j’en pense. L’influence de la diffusion est très faible, car tout au plus nous fait-elle voir le ciel en bleu le jour. Elle se constate également lorsque le soleil se couche. La lumière traverse alors une épaisse couche d’air et il en résulte une légère diffusion, à l’origine de la beauté des couchers de soleil. Par contre, la nuit, il fait bel et bien noir, c’est tout au moins la raison pour laquelle nos voitures sont équipées de phares pour y voir clair ! L’argument de la diffusion est donc sans valeur. Admettre un rayonnement entrant de 340 W/m² la nuit, c’est admettre qu’il ne fait pas noir la nuit. Pour ce qui est de la circulation océanique ou atmosphérique, phénomènes par contre d’importance, ils sont à prendre en compte dans les caractéristiques propres à la Terre, et non pas avec le rayonnement solaire, avec lequel ils n’ont rien à voir non plus.
Détaillons l’ensemble de ces erreurs, pour bien comprendre que ce sont toutes de profondes erreurs de raisonnement.
Employer par exemple l’argument de l’inertie thermique, c’est donc mélanger l’étude du seul rayonnement solaire dont on cherche à mesurer l’influence sur un astre ( ici la Terre ) avec les propriétés internes de cet astre. La présence d’un océan est une caractéristique propre à la Terre, caractéristique qui n’existe pas sur d’autres astres, comme la Lune. Commencer à mélanger l’influence du rayonnement solaire avec les caractéristiques de l’astre ne peut que fausser le raisonnement que l’on doit tenir. Si l’on veut respecter la logique, ce raisonnement doit comporter deux phases. La première est d’analyser ce qui vient du Soleil, aussi bien pour la Terre que pour la Lune, et la seconde d’analyser ensuite les conséquences sur la température des caractéristiques particulières à l’astre étudié ( ici la Terre ) et de les comparer notamment avec les caractéristiques d’un autre astre, ici la Lune, placé par rapport au Soleil exactement dans les mêmes conditions de distance et de puissance entrante.. En effet, le but du raisonnement ici est précisément de comprendre pourquoi, à égalité de distance de la source du rayonnement qu’est le Soleil, donc à égalité de puissance au mètre carré agissant sur les deux astres que sont la Lune et la Terre, on observe pourtant de telles différences de température.
Insistons encore et ajoutons quelques précisions :
La méthode correcte de raisonnement doit impérativement commencer par évaluer ce qui peut l’être en prenant soin d’isoler totalement l’influence du seul et unique rayonnement solaire, afin de se rendre compte de ce que notre étoile fait sur les deux astres. Autrement dit il convient d’évaluer d’abord ce qui leur est commun.
L’inertie thermique interviendra, bien entendu, mais, dans un raisonnement correct, après, dans la seconde phase, lorsque nous voudrons comprendre les raisons des différences de température entre la Lune et la Terre. Et, précisément, cette différence entre l’inertie thermique considérable des océans et l’inertie thermique au contraire très faible des régolites lunaires est la principale et la toute première explication de ces différences. Il tombe sous le sens que la présence d’un océan sur Terre alors que la Lune n’en possède pas est primordiale et largement plus lourde de conséquences sur leurs températures respectives que la présence ou non de gaz à effet de serre. Or, le raisonnement qui est fait est à l’envers à ce propos. Au lieu d’analyser ce fait, on attribue à l’océan la propriété de modifier le rayonnement solaire, celui-ci devenant distribuable sur la Terre entière, alors que ce qui est réellement modifié par la présence d’un océan, c’est la température au sol.
Il est souvent ajouté que la Terre tourne. Cet argument ne tient pas, parce que la Lune aussi tourne. Il est encore ajouté, lorsqu’on explique ce dernier fait, que la Lune tourne moins vite que la Terre. Cet argument ne tient pas non plus, pour une autre raison. La vitesse de rotation respective de la Terre et de la Lune ne dépendent pas du rayonnement solaire qui leur parvient, mais par contre ces vitesses sont des caractéristiques de ces deux astres. Sur quoi influent ces caractéristiques ? Encore une fois, sur les températures et non pas sur le rayonnement solaire qui reste bel et bien le même. Ce rayonnement ne dépend pas de la durée de la rotation de ces deux astres. Par conséquent cette différence de durée doit être prise en compte comme différence entre les caractéristiques des deux astres, et non pas comme prétexte pour ne pas les comparer. C’est la logique même. La Lune en effet a plus de temps pour se refroidir la nuit. Tout cela doit être pris en compte dans la seconde phase et non pas pour mélanger ce phénomène avec le rayonnement solaire, dans un raisonnement mené correctement, c’est-à-dire dans le bon ordre. Répétons cet ordre, c’est indispensable pour bien comprendre les erreurs qui sont faites :
a) Analyse et chiffrage si possible du seul point commun entre la Terre et la Lune, le rayonnement solaire qui y parvient, et ses conséquences sur les températures respectives.
b) Analyse et chiffrage si possible des différences entre la Terre et la Lune et leurs conséquences sur les températures respectives.
L’inertie thermique et la différence de vitesse de rotation entre les deux astres doivent être traitées dans la partie b), en même temps que les conséquences de l’existence ou non d’un océan et d’une atmosphère, qui font partie des différences entre les deux astres. Il est proprement incroyable que ces différences soient prises comme prétextes pour dire qu’on ne peut pas comparer les deux astres. C’est renoncer à prendre en compte leurs différences principales, extrêmement importantes en termes de température, au profit d’une différence complètement mineure, à savoir la présence de gaz à effet de serre dans l’atmosphère de la Terre. Ce n’est donc rien d’autre qu’une très grave faute scientifique, une erreur de méthode que j’appelle ici faute structurelle. Le raisonnement tenu ne tient pas debout.
Résumons les choses : dans la réalité, l’inertie thermique influence la température qui règne sur la Terre. Les raisonnements qui sont faits confondent ou mélangent le rayonnement solaire et la température. L’analyse menée en est profondément faussée.
Ajoutons en second lieu que l’inertie thermique de l’océan, qui est situé au sol, ne peut pas faire sentir son influence tout en haut de l’atmosphère, comme le suggère le schéma ci-dessous. L’inertie thermique de l’océan n’est pas, cela parait évident, redisons-le, une propriété télé-portable à environ 10 à 20 km d’altitude, justifiant par là la distribution qui est faite. De même la rotation de la Terre comme celle de la Lune n’influence pas la direction ni la puissance du rayonnement solaire qui arrive. Cette rotation joue encore une fois, sur les températures.
Or, au lieu de suivre une démarche logique en deux phases, expliquées plus haut, à quoi assistons-nous ? Au lieu de comparer la vraie Terre, tournant en 24 h, munie d’un océan et d’une atmosphère contenant des gaz à effet de serre, avec la vraie Lune, tournant en 28 j, privée d’atmosphère et d’océan, comparaison que l’on se refuse à faire et dont on conteste même la légitimité lorsque des scientifiques sensés la font, que compare-t-on ? La réponse est parfaitement claire : la Terre est comparée non pas avec un astre réel, mais avec une chimère qui n’existe pas et ne peut même pas exister, à savoir un astre avec un océan que l’on n’a pas enlevé, avec une atmosphère que l’on n’a pas enlevé non plus, mais pas de gaz à effet de serre, que très étrangement l’on s’autorise par contre à enlever. Cela n’a aucun sens. Un tel astre ne peut exister d’autant qu’en outre il possèderait un albédo identique à la vraie Terre, alors que sans eau en tout cas, l’albédo ne peut pas rester le même. Répétons-le : cela n’a aucun sens.
Et c’est avec cette comparaison chimérique que l’on tire des conclusions permettant soi-disant d’affirmer l’existence d’une cause anthropique au réchauffement climatique observé. Je parle de la conclusion totalement absurde dans ces conditions qu’il ferait -18°C au sol sans les gaz à effet de serre. Dans la réalité, si l’on tient compte de toutes les différences entre la Terre et la Lune, un conclusion beaucoup plus plausible est de dire qu’il ferait sur la Terre une température relativement comparable à celle de la Lune, qui est en moyenne comprise entre -70°C et -80°C environ, mais surtout varie de – 200°C la nuit voire moins à plus de 120°C le jour au zénith. Cela n’a aucun rapport avec le chiffre sans signification aucune de -18°C qui est avancé.
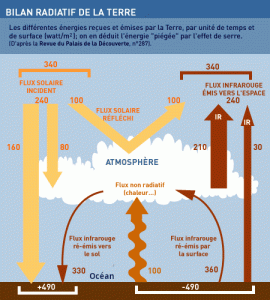
d) De façon plus technique, la manière d’utiliser une loi de thermodynamique appelée loi de Stefan-Boltzmann est inappropriée. Cette loi ne peut s’appliquer qu’en un « point » (ce qui veut dire en une surface de 1 m²) et de façon instantanée. Il existe encore d’autres conditions, notamment des conditions d’équilibre entre rayonnement entrant et rayonnement sortant. Je ne m’étendrai pas là-dessus ici, ce point est développé dans la page titrée « Stefan-Boltzmann ».
Or cette loi est appliquée à une moyenne portant sur 24 h. Ceci est contraire aux lois de la physique et aux lois mathématiques. Une fonction mathématique non linéaire, c’est-à-dire une fonction où les valeurs de la variable calculée (ici la température T) ne sont pas proportionnelles à la variable de départ (ici la puissance P) ne vérifie pas la propriété d’application à des moyennes. Autrement dit l’image d’une moyenne n’est pas la moyenne des images. Ici la moyenne des racines quatrièmes n’est pas la racine quatrième de la moyenne. Voici un exemple : prenons les deux températures correspondant aux deux puissances suivantes : 420 W/m² et 0 W/m². On trouve les valeurs de T suivantes, en conservant un albédo de 0.3 : 268 K et 0 K. La moyenne des images est de 134 K, alors qu’en calculant l’image de la moyenne, qui est de 210 W/m², on trouve une température de 225 K. L’erreur est considérable !
e) Aucun des bilans énergétiques de la Terre qui sont présentés ne prend en compte un phénomène très différent de l’éclairage solaire et causé, dans le cas de la Terre et de bien d’autres astres par la présence d’une atmosphère. Ce phénomène n’existe pas sur la Lune, alors qu’il explique pour une part significative la différence entre les températures observées sur les deux astres. Ce phénomène est la gravitation, qui est à l’origine sur Terre de ce que nous appelons le gradient thermique, en clair de la différence de température qui règne dans l’atmosphère en fonction de l’altitude. Il fait de plus en plus froid au fur et à mesure que l’on gagne en altitude. Ceci a des conséquences sur la température au sol, par rapport à la température globale du système Terre-atmosphère. Ces conséquences n’ont pas lieu sur la Lune, puisqu’il n’y a pas d’atmosphère sur cette dernière. La température moyenne globale de la Lune est celle de son sol. La température moyenne globale du système Terre-atmosphère n’est par contre pas celle du sol de ce système. La température moyenne au sol représente plutôt un maximum par rapport aux moyennes de températures régnant aux différentes altitudes. Très rares sont les théories du climat qui tiennent compte correctement de ce phénomène important qu’est la gravitation. Sans la gravitation, la situation serait grave : l’atmosphère disparaitrait peu à peu, comme elle a disparu sur certains astres où la gravitation était trop faible pour pouvoir retenir une atmosphère. La négliger est une faute scientifique. D’où vient, pour reprendre cet exemple, la température qui règne à la surface du Soleil ? Je vois venir la réponse : « Elle vient des réactions nucléaires qui se déroulent au centre de l’étoile ». C’est d’accord, mais… Pourquoi y a-t-il des réactions nucléaires au centre du Soleil ? La réponse est extrêmement claire : elles viennent de la gravitation, qui crée des pressions tellement élevées au centre du Soleil que ces pressions déclenchent des réactions de type nucléaire. C’est dire l’importance que peut revêtir la gravitation sur la température au sein d’un astre. La négliger sur Terre, où la gravitation se contente de créer un gradient thermique bien réel et bien connu des pratiquants de vol libre et la remplacer par l’influence des gaz à effet de serre est plus qu’une faute scientifique. C’est une négation de ce qu’est l’humanité, en lui prêtant des pouvoirs qu’elle n’a pas et qu’a par contre cette force immense qu’est la gravitation. C’est donc une démarche incompréhensible, sans aucun fondement scientifique sérieux. Je pèse mes mots ici, et j’ajoute que je n’ai rien à voir avec les milieux dits « complotistes » qui voient là-dedans des manipulations plus ou moins volontaires de « ceux qui nous dirigent ». Je n’y vois moi qu’un aveuglement collectif, un aveuglement qui atteint non seulement toute la population, mais également une grande partie de la communauté scientifique… ce que je ne comprends pas.
La fausseté des calculs qui sont faits est poursuivie et analysée plus en détail dans les deux sous-onglets en dessous de celui-ci, intitulés « Calculs faux » et « Inconcevable ». Les lire dans cet ordre.
